Cinéma: Razzia, de nabil Ayouch
Razzia, un film de Nabil Ayouch
Ou l’art de se tromper de colère.
1982. Un instituteur renonce à ce qui fait sa joie : enseigner aux enfants la beauté du monde. L’arabisation forcée exerce sa violence religieuse jusque dans ces superbes montagnes reculées de l’Atlas marocain, et les écoliers kabyles, magnifiquement filmés, n’y comprennent plus rien. Eux si vivants auprès de leur maître se mettent à ânonner des phrases apprises par coeur. Il renonce et fuit, laissant aussi au village son amour pour une femme qui a pris pour lui la liberté d’ignorer le jugement de ses voisins. Il signe ainsi le début d’une tristesse et d’une culpabilité sans fin.
Puis de nos jours, à Casablanca. Où la révolte gronde dans la rue. Menaçant de tout brûler, tout renverser sur son passage. Elle dit le chômage, la précarité, l’absence d’horizon, l’avenir confisqué. La jeunesse s’arme de bâtons et de torches, renverse les voitures, cogne sur tout ce qui bouge. On sent une revendication manipulée par la religion, une peur qui se crispe sur la fausse sécurité d’un retour aux traditions. Les slogans se cherchent, des femmes défilent contre leur propre émancipation.
Casablanca moderne, froide et vibrante, si loin des villages kabyles. Une jeunesse dorée y vit dans des appartements au design impeccable et glacé, y parle encore français, y méprise ses employées de maison pourtant bien marocaines, on se croirait chez des expatriés au temps de l’occupation française. Les jeunes filles y sont libres, nourries aux clips télévisés, maquillées, chahuteuses. Elles parlent drague et sexe (s’inquiètent cependant de leur virginité), elles se rendent à des fêtes électriques en voiture décapotable…Derrière cette adolescence décomplexée, apparemment loin des burkas et des interdits, on pressent une schizophrénie, un irréconciliable et mortifère grand écart entre tradition et modernité, d’autant plus dangereux qu’il n’est pas annoncé. Une perte complète de repères. Sans mots pour le dire. Amer symbole de cette étrange jeunesse : Une adolescente si seule, si perdue aux côtés d’une mère « libérée », qui revêt robe traditionnelle par-dessus son jean et foulard sur ses cheveux détachés, triste déguisement, pour prier, télévision allumée sur un clip où des filles en short se déhanchent.
Hakim est musicien. Il chante dans un groupe de rock, écrit des textes où il exprime à quel point lui et ses copains se sentent perdus dans un monde qui change, qui bouge, mais où on leur interdit d’être ce qu’ils sont. Où chanter et jouer de la guitare c’est être pédé. Où le silence et le regard fuyant d’un père en dit long sur le déni et la non reconnaissance de soi. Il rêve de partir mais il reste. Seule sa petite sœur croit tendrement en lui. Une fille, encore, pour garder l’espoir d’une résistance. Et il finit dans une bagarre par cogner sur sa propre impuissance, sur sa propre rage.
Joe n’a pas de colère, juste une incompréhension puis une lente tristesse qui infuse peu à peu dans son regard et qui peut-être un jour viendra à bout de sa joie de vivre et de sa confiance. Il est juif, vit avec son vieux père qu’il protège et qu’il tente de rassurer dans un monde où tout change entre les Arabes et les Juifs. Il tient un restaurant chaleureux, est ami avec Ilyas, un de ses serveurs qui lui, est arabe. Il aime rire, il est amoureux. L’amitié peut encore se partager, l’amour c’est déjà plus difficile. Combien de temps encore être juif à Casablanca ne sera pas un problème ? Quelque chose est menacé, quelque chose vacille.
Et puis il y a Salima. Filmée au plus près du visage et du corps (comme les femmes de « Much loved »), elle est la grande résistante du film parce qu’elle va jusqu’au bout de ce qu’elle veut être sa liberté.Elle danse, elle remonte encore un peu plus sa robe sur ses cuisses quand elle se fait traiter de putain dans la rue. Elle veut travailler. Elle allume une deuxième cigarette quand son compagnon, pourtant très « moderne » et là encore d’autant plus menaçant, et qui voudrait tellement réussir à la contrôler, lui interdit de fumer. Elle ne renonce à rien. Elle provoque. Ne se soumet pas. Sans violence. Mais sans compromis possible. Enceinte, elle garde sa grossesse pour elle, choisit de ne pas avorter, au « risque » assumé que l’enfant soit une fille, et elle quitte l’appartement où elle vit. C’est la presque dernière image du film, magnifique : Sur une plage, elle enlève ses chaussures, relève se robe sur son ventre nu de femme enceinte et avance dans l’eau, visage offert au soleil, profondément libre de toute oppression.
Des fils ténus se tissent entre tous ces personnages. Des bribes d’histoire commune, entre 1982 et maintenant, du village kabyle à Casablanca. Des trajectoires heurtées, des rêves, des espoirs, des révoltes, de beaux instants de douceur, malgré tout. L’instituteur, devenu vieux, seul, silencieux, regarde par la fenêtre le monde errer et se défaire. Il a perdu son livre de poèmes.
Véronique Garrigou




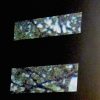






Leave A Comment